
Horizons de politiques Canada – L’avenir de la valeur (5)
Je continue mon analyse du rapport L’avenir de la valeur du think tank fédéral Horizons de politiques Canada en passant à la sixième activité humaine de base, c’est-à-dire le transfert de connaissances, afin de voir de quelle manière les nouvelles technologies pourraient affecter la rareté et provoquer des changements de valeur dans ce domaine selon les rédacteurs du rapport, et pour essayer d’en dégager les implications politiques sous-jacentes.
Je présume que cette activité, comme la « production » de connaissances, concerne tout particulièrement plusieurs de mes lecteurs, qui enseignent, qui ont enseigné ou qui aimeraient enseigner. Puis, en tant que citoyens, les manières dont on pourrait transformer le transfert de connaissances nous concernent tous, car elles peuvent s’inscrire dans un projet politique susceptible d’avoir des effets considérables. Ceux qui influencent ou contrôlent la transmission de ce qui passe, à tort ou à raison, pour des connaissances sont assurément très puissants. C’est pourquoi le savoir autorisé et diffusé a toujours été l’enjeu de luttes ouvertes ou cachées entre des groupes d’intérêts concurrents, ou entre les gouvernants et les gouvernés.

La définition de cette activité est simpliste. Sa formulation laisse entendre que la savoir est quelque chose de donné, de connu comme savoir, de fixe et de statique, qu’on déverse dans le cerveau d’un auditeur ou d’un interlocuteur. De la même manière que la production de connaissances pose problème quand on la sépare de l’acquisition des données à partir desquelles elle est censée se faire, le transfert de connaissances suppose l’existence d’un savoir – ou de ce qui passe pour tel – qui fait partie d’acquis que l’enseignant peut communiquer aux personnes qui l’écoutent, et qui ont une existence indépendante de la démarche qui permet de les considérer comme savoir. S’il n’est certainement pas question de recommencer tout du début quand on enseigne, disons les mathématiques ou la physique, il est par contre nécessaire d’avoir recours à des démonstrations ou à des expériences pour montrer le bien fondé de ce qu’on enseigne comme étant des savoirs. Donc, si on s’en tient à un transfert de connaissances, les connaissances transmises ne sont pas comprises comme des connaissances par les personnes auxquelles elles sont transmises, et ne sont donc pas des connaissances pour elles. Il est même à craindre que l’enseignant, en tant que courroie de transmission des connaissances, indépendamment de ce qui les justifie comme connaissances, en vienne à avoir un rapport avec ces connaissances qui n’est pas celui du savoir, à plus forte raison si l’enseignement qu’il a lui-même reçu a été un simple transfert de connaissances.
On dira que c’est seulement une manière de parler, et que par transfert de connaissances on n’entend pas simplement un transfert de connaissances pris au sens strict. À cela je réponds que c’est assurément une manière de parler, mais que ce n’est pas seulement une manière de parler, les manières de parler étant très importantes, de manière générale et plus particulièrement quand on enseigne ou quand on prétend transmettre des savoirs, comme les rédacteurs de ce rapport croient sans doute le faire.
Le fait qu’on mette dans la même catégorie, et donc sur le même plan, des activités aussi différentes que l’enseignement, les conseils médicaux, juridiques ou financiers et certains aspects du service à la clientèle et de l’assistance administrative montre bien qu’on n’a pas une idée très élevée du transfert des connaissances et des connaissances elles-mêmes. Puisqu’on peut difficilement élever le service à la clientèle au niveau de l’enseignement, on peut craindre qu’on abaisse plutôt l’enseignement au niveau du service à la clientèle, étudiante en l’occurrence.
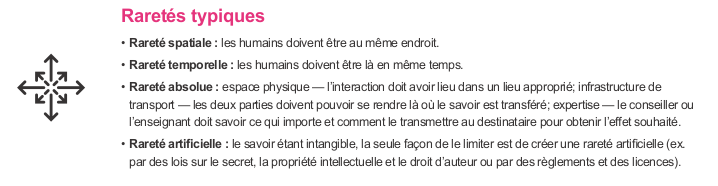
Toujours la même obsession sur la rareté spatiale et temporelle. Comme si c’était une corvée ou même une longue expédition d’avoir à se déplacer, par exemple, pour donner ses cours ou y assister, et se trouver au même endroit que ses étudiants ou ses professeurs. Encore pire, il faudrait des salles de cours, des pavillons et des campus, et il faudrait que les étudiants s’y déplacent en utilisant des moyens de transport sujets à la rareté. Puis il y aurait la rareté des gens capables d’enseigner. Si bien que les étudiants sont contraints de quitter leur lieu de naissance pour aller s’établir en ville pour poursuivre leurs études. Quelle perte de temps, d’argent et d’énergie, dira-t-on !
Pourtant nous avons tous fait nos études de cette manière jusqu’à maintenant. Loin de voir dans l’obligation de se déplacer à des dizaines ou à des centaines de kilomètres du domicile familial une mauvaise chose, nous y avons vu pour beaucoup une occasion de nous libérer de l’autorité parentale et de devenir enfin des adultes plus ou moins autonomes. Ce déplacement, qui après tout n’a pas été si difficile à réaliser et si problématique, a plutôt rendu possible l’une des périodes les plus intéressantes de ma vie et m’a permis de devenir ce que je suis maintenant, en me faisant sortir d’un milieu familial et campagnard très pauvre culturellement. La rareté a donc quelque chose de bon. J’aurais été très fâché de pouvoir et de devoir continuer mes études dans mon petit village ou sur la Côte-Nord, dont je serais peut-être resté prisonnier.
La manière dont on décrit la rareté artificielle fait contraste avec les autres formes de rareté. Alors que la rareté spatiale, temporelle et absolue serait un état de fait qu’il s’agirait de surmonter, il s’agirait ici de limiter la propagation du savoir et de produire la rareté artificielle grâce à des lois sur le secret, à la propriété intellectuelle, au droit d’auteur ou à des règlements et des licences, dont l’utilisation plus fréquente et plus étendue accompagne l’apparition des nouvelles technologies et la diffusion des connaissances qu’elles facilitent.
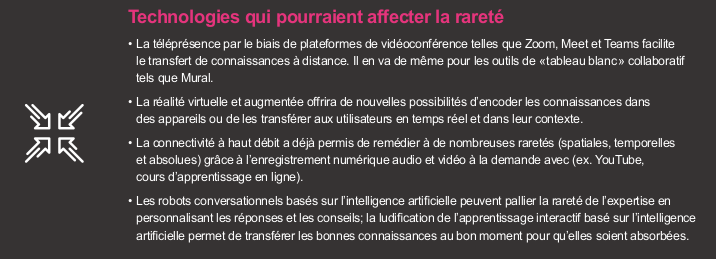
Il s’agit donc d’utiliser les nouvelles technologies pour remplacer le transfert de connaissances « en présentiel », notamment l’enseignement, par leur équivalent à distance ou en ligne. Sous le terme pompeux de téléprésence se cache seulement des plateformes de vidéoconférence, alors que je croyais qu’on référait à des technologies en développement qui pourrait avoir recours à la réalité virtuelle, à la fois pour se projeter dans un lieu distant de manière à être vu par les personnes présentes comme si on y était pour de vrai, et pour avoir toutes les perceptions d’une personne qui s’y trouverait vraiment. Ce n’est donc pas la grande affaire. Si la perte peut être minimale en ce qui concerne les conseils juridiques et financiers, le service à la clientèle et l’assistance administrative, elle serait beaucoup plus grande en ce qui concerne l’enseignement en classe. La dynamique d’un cours en classe et d’un cours par vidéoconférence est très différente. La relation entre les professeurs et les étudiants est plus riche en classe. Le langage corporel, qui ne se limite pas à l’expression du visage, mais qui comprend aussi les gestes et les mouvements du professeur, joue un rôle important dans l’enseignement. À l’inverse, les réactions de la classe sont beaucoup plus perceptibles en classe que par vidéoconférence. Puis l’enseignement et l’apprentissage ne se réduisent pas à ce qui se dit en classe : il y a les conversations informelles avec les professeurs ou d’autres étudiants, pendant les pauses ou au gré des rencontres dans les couloirs. Enfin, certains professeurs peuvent servir de modèles intellectuels et moraux, et il y a aussi l’émulation entre étudiants, ce qui tend à arriver plus difficilement et avec moins d’intensité quand l’éducation se réduit essentiellement à des cours par vidéoconférence.
On aurait donc tort de sous-estimer l’importance des milieux d’enseignement dans l’apprentissage. Et cela vaut aussi pour les élèves du primaire et du secondaire, qui pourraient voir leur éducation – qui n’est pas seulement une affaire de transfert de connaissances – appauvrie par l’importance grandissante accordée à l’enseignement à distance, et l’enfermement dans un milieu familial donné et social donné qui impose des limites à leur développement intellectuel et moral. C’est seulement en assimilant l’éducation et l’enseignement au service à la clientèle et à l’assistance administrative qu’on peut ne pas voir la chose. Le recours à la réalité augmentée, à des outils de tableau blanc, à des robots conversationnels ou à l’apprentissage grâce à des jeux interactifs ne saurait pas compenser les élèves pour cet appauvrissement de leur éducation. Il ne s’agit pas d’instruire les enfants pour en faire des chiens savants, mais de les éduquer pour en faire des adultes autonomes, capables d’assumer les droits qui leur reviennent ou devraient leur revenir en tant que citoyens. Bref, en voulant surmonter avec les nouvelles technologies les raretés typiques du transfert de connaissance, on rendrait encore plus rare une éducation publique digne de ce nom.
Maintenant un point de détail, mais qui est tout de même important. Comment ferait-on pour permettre aux élèves et aux étudiants d’acquérir certaines connaissances scientifiques en misant sur l’enseignement en ligne ou virtuel, et en négligeant l’apprentissage de la méthode expérimentale dans des laboratoires ? Le remplacement de ces expériences en laboratoire par des simulations numériques n’auraient pas tant pour effet de permettre l’acquisition d’une certaine culture scientifique, que de développer la confiance en ces simulations qui tendent à se substituer à la réalité et à l’expérience, avec tous les problèmes que cela pose (voir le billet précédent).
Enfin, il n’est pas question, dans les usages qu’on pourrait faire des nouvelles technologies, de surmonter la rareté artificielle, qu’on pourrait d’ailleurs accroître en assujettissant le contenu éducatif en ligne à la propriété intellectuelle et aux droits d’auteur. Ne serait-ce pas remplacer une rareté par une autre ? Qu’y gagnerions-nous ?
Et si nous envisageons les choses d’un autre point de vue que la simple rareté, la réglementation, la surveillance et le contrôle des nouvelles technologies et des plateformes utilisées ne pourraient-elles pas permettre une certaine forme de censure par les organismes gouvernementaux, les institutions d’enseignement et les géants du numérique ? Puisque la question des politiques portant sur les nouvelles technologies et de l’indépendance des plateformes est omise, puisqu’on fait comme si certaines conditions ne devaient pas être réunies pour qu’il n’y ait pas censure et pour que les connaissances puissent se propager librement, il est légitime de nous demander si les auteurs de ce rapport s’accommodent fort bien de cette censure, qu’ils n’appellent peut-être pas ainsi, mais qui serait à leurs yeux garante de la transmission de véritables savoirs, par opposition aux « fake news » et aux thèses dites complotistes. Chose certaine, la libre circulation des connaissances n’est pas un effet nécessaire du recours à ces nouvelles technologies, mais dépend de la fonction politique qu’on leur donne et de la réglementation (ou l’absence de réglementation) qui s’applique à elles.
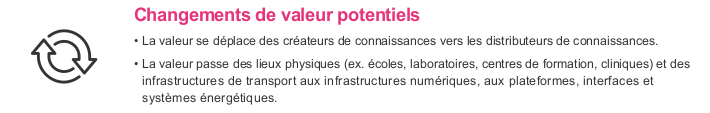
Il est étrange qu’on parle ici d’un déplacement de la valeur des créateurs de connaissances vers les distributeurs de connaissances, puisqu’il devrait seulement s’agir ici des changements qui affecteraient le transfert des connaissances, et non la création des connaissances. Cela s’explique peut-être par le fait qu’il est plus facile d’utiliser les nouvelles technologies et l’intelligence artificielle pour transmettre ce qui est reconnu à tort ou à raison comme des savoirs, que pour en créer. Ce qui constitue un risque important pour la connaissance, car les personnes qui participent directement ou indirectement (par la programmation de l’intelligence artificielle, par exemple) à la diffusion ont assurément une moins bonne compréhension des connaissances que leurs créateurs et, à la rigueur, se considèrent seulement comme des vecteurs de transmission qui n’ont pas à comprendre à fond ce qu’ils transmettent, l’essentiel étant pour eux dans la transmission. Ou encore ils peuvent imaginer qu’ils comprennent ce qu’ils diffusent quand ce n’est pas le cas, faute d’avoir compris quoi que ce soit d’un peu complexe et de savoir ce que ça implique. S’ils en viennent à avoir une plus grande valeur que les créateurs de connaissances, ces diffuseurs et les entreprises qui contrôlent les plateformes de communication prétendent dicter aux penseurs et aux scientifiques ce qui est une connaissance et ce qui est une erreur ou un mensonge. Disposant de puissants moyens de communication, non seulement ils nous gavent de prétendus savoirs qui nous dispenseraient de penser (nous connaîtrions déjà la vérité), mais ils sont alors en mesure d’ignorer ou de discréditer les résultats des analyses ou des expériences faites par les créateurs de connaissances, sous prétexte qu’il s’agirait de théories délirantes et d’erreurs dangereuses et criminelles dont il faudrait arrêter la propagation. C’est ce qui se passait déjà avant l’arrivée du virus, c’est ce qui se passe encore plus depuis l’arrivée du virus et c’est ce qui se passera encore plus si nous continuons à accorder encore plus d’importance aux diffuseurs de « connaissances ». Le débat public, déjà très difficile, pourrait devenir impossible, et avec lui la démocratie. Nos autorités politiques et sanitaires pourraient continuer à nous mener par le bout du nez et à nous gouverner comme de simples sujets, comme de simples serfs, en nous imposant dogmatiquement des décisions indiscutables et en bénéficiant de l’appui inconditionnel de tous les régurgiteurs de « connaissances ». Voici les armes que ce think tank voudraient mettre entre les mains de ceux qui nous gouvernent, sous prétexte de progrès technologique. À moins de les croire capables d’une bêtise incommensurable, il est difficile de ne pas penser que ça ne s’inscrit pas dans un projet de transformation politique.
En ce qui a trait au déplacement de la valeur des lieux physiques et des infrastructures de transport vers les infrastructures numériques et les plateformes – qui convergent avec les changements de valeur signalés dans les autres activités –, on en vient à se demander, à terme, ce qui restera. En ce qui concerne les édifices, ce serait à peine exagéré de répondre : rien d’autre que les domiciles privés, qui deviennent le lieu de toutes les activités auxquelles nous pourrions participer, virtuellement. À quoi bon se déplacer s’il ne reste presque nulle part où aller ? À quoi bon entretenir et réparer des infrastructures de transport ? Aussi bien rester à la maison. Voilà tout un projet de société, lequel concorde avec les grandes orientations politiques adoptées depuis l’arrivée du virus.
Je conclus en faisant remarquer que, si jamais nous persistions à vouloir nous déplacer pour étudier dans les quelques universités qui pourraient continuer à exister, les frais de scolarité et de transport pourraient être prohibitifs en raison de la rareté produite par l’usage des nouvelles technologies pour faire de l’éducation en ligne la nouvelle norme. Si bien que cette éducation serait réservée seulement ou principalement aux élites économiques. Autrement dit, on aggraverait la rareté qu’on prétend surmonter grâce à ces nouvelles technologies.