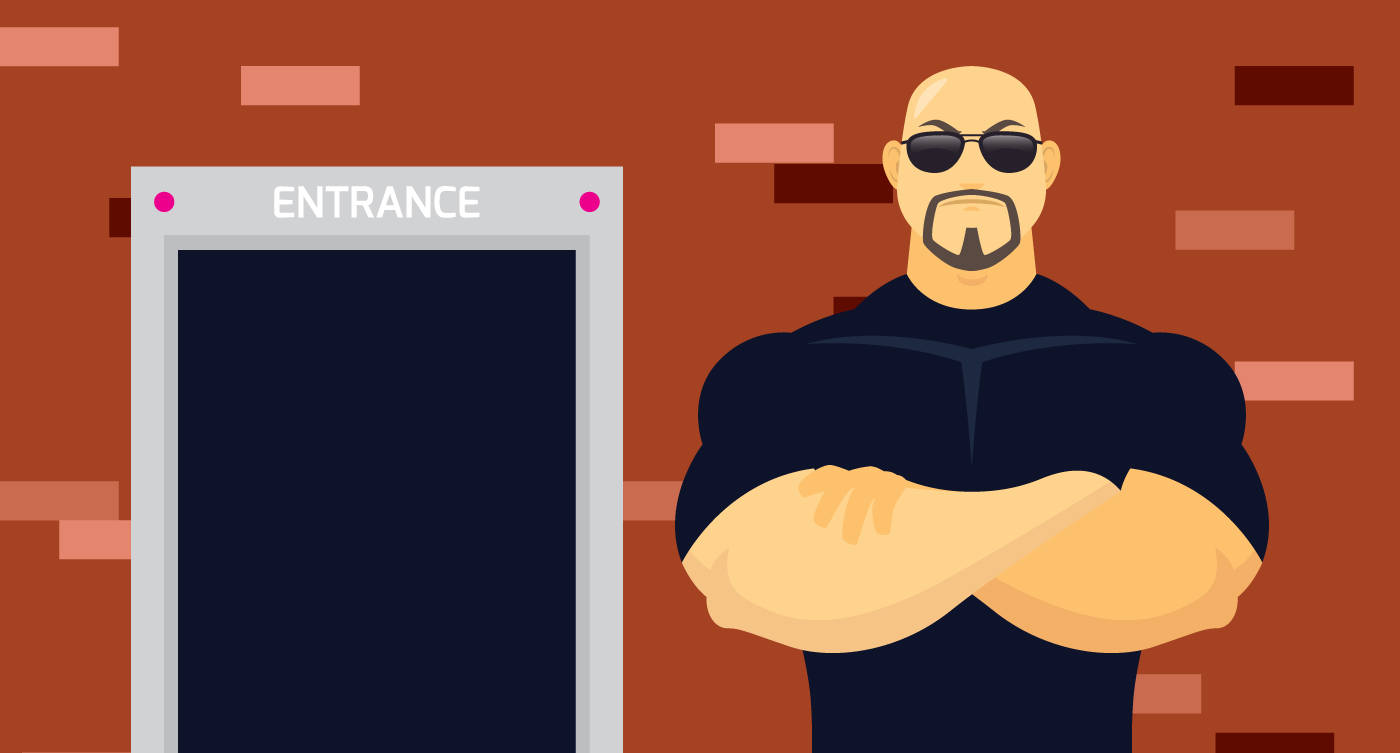
Nulle part chez nous
En temps normal comme en temps de crise, et à plus forte raison dans cette nouvelle normalité où se combinent les crises réelles et les crises imaginaires, on cherche à nous faire sentir que nous ne sommes nulle part chez nous. Ce « on », ce sont les différents paliers de gouvernement, ce sont les grandes corporations, ce sont les commerces, ce sont nos employeurs, ce sont les administrations scolaires et sanitaires, ce sont les policiers et les agents de sécurité, ce sont nos voisins, nos collègues et notre entourage, etc. C’est pour ainsi dire presque tout le monde. Cette situation est de toute évidence rendue possible par le fait que nous, qui faisons partie du peuple, nous soucions assez peu de notre liberté et de la protection de notre vie privée, ne sommes pas dérangés par les intrusions constantes, abusives et gratuites des autres dans notre existence et par la prise de contrôle de tous les lieux publics et même des lieux privés, et nous plaisons souvent à intervenir dans la vie des autres et à voir les autorités, quelles qu’elles soient, y intervenir. Cette situation est particulièrement visible dans les villes, qui sont en train de devenir de plus en plus invivables, de manière générale et surtout pendant les épisodes de délire sanitaire.
Au plus fort des confinements, on nous a bien fait sentir que « chez nous », cela voulait dire seulement notre domicile et excluait la ville et le quartier où nous vivions. Il nous fallait autant que possible rester « chez nous », compris dans ce sens très restreint. Les rues étaient surveillées par des policiers à pied et à vélo, des auto-patrouilles, des hélicoptères, parfois des drones, et même des robots dans certains pays, pour veiller au respect de la distanciation sociale, et plus tard au respect du couvre-feu. Nous avons été exclus de tous les commerces et de tous les lieux publics non essentiels, fermés sous prétexte de nous protéger. Pour ceux d’entre eux qui étaient restés ouverts, on nous demandait de ne pas dépasser le nombre de personnes autorisées à l’intérieur, de faire la file à l’extérieur et à l’intérieur, de mettre un masque et de nous désinfecter les mains à l’entrée, de respecter la signalisation, de ne pas toucher inutilement la marchandise et de sortir aussi rapidement que possible pour laisser d’autres clients entrer. Quand les autres commerces et les autres lieux publics ont été autorisés à rouvrir, les autorités politiques et sanitaires semblent avoir tout fait pour que nous nous n’y sentions pas les bienvenus et pour que nous nous y sentions même de trop. Il est assez rebutant d’avoir à donner nos coordonnées dans un restaurant ou dans un bar pour être contactés en cas de soi-disant éclosion et obligés d’aller passer un test de dépistage, ou encore de présenter un passeport vaccinal et une pièce d’identité. Même si les propriétaires ou les gérants de ces commerces n’avaient souvent pas à se faire prier pour appliquer les mesures soi-disant sanitaires et rebutaient ainsi une partie de leurs clients, d’autres sentaient clairement qu’ils n’étaient plus maîtres dans leurs propres commerces, et que les autorités politiques et sanitaires avaient pris le contrôle de ce qu’ils pouvaient y faire, et pouvaient décider de les faire fermer en cas de non-respect de ces mesures ou de soi-disant éclosion. Et quand nous sommes retournés au travail ou dans les cégeps et les universités, alors que le méchant virus continuait de circuler, on a tout fait pour nous faire sentir que nous étions avant tout des vecteurs de contagions, et que nous ne devions pas prendre nos aises dans les aires communes et même à notre place, à notre bureau ou en classe. Durant cette période sombre, nous ne pouvions même pas disposer librement des maisons ou des condominiums que nous avions achetés et des appartements dont nous payions le loyer, puisque nous ne pouvions même pas recevoir chez nous nos amis et notre famille sans courir le risque d’être dénoncés par un voisin, le concierge ou le propriétaire et de recevoir une visite de la police et une amende. Ce qui revient à ne pas être chez nous dans nos propres domiciles.
Le plus curieux, c’est que les autorités politiques et sanitaires, les journalistes et les bien-pensants ont commencé à se soucier de la jouissance de la ville d’Ottawa par ses résidents quand le Freedom Convoy y est arrivé. Les klaxons, l’odeur persistante de diesel, les camions qui encombraient les rues et tous ces étrangers (surtout les gros barbus intimidants), nous a-t-on dit, incommodaient les Ottaviens et faisaient qu’ils ne se sentaient plus chez eux dans leur propre ville. C’est pourquoi les manifestants auraient dû quitter Ottawa par respect pour ses résidents, alors qu’entre autres ils réclamaient justement le droit pour tous les Canadiens de pouvoir jouir librement des lieux où ils vivent, et qu’on les considérait comme des étrangers et même des envahisseurs dans la capitale de leur pays.
Nous aurions tort de croire que toutes ces mesures qui ont pour effet ou pour but de ne nous faire sentir chez nous nulle part, de ne pas nous faire sentir les bienvenus, et même de nous faire sentir de trop, ont commencé et ont pris fin avec l’état d’urgence sanitaire. Cela a commencé bien avant et continue après.
Surtout pendant l’été, la vocation de plusieurs secteurs de nos villes change, et ceux-ci deviennent à peu près infréquentables pour leurs habitants. Il s’agit d’attirer et d’accueillir les touristes, pour lesquels on organise des festivals, des expositions et des activités, on ouvre des kiosques et des boutiques temporaires, on autorise des amuseurs et musiciens de rue à nous casser les oreilles, et on rend payant l’accès à des parcs où sont tenus des événements.
Durant le printemps, l’été et l’automne, les rues et les autoroutes sont envahies par les entrepreneurs en construction. Que nous nous déplacions en voiture, en autobus, à vélo ou à pied, que nous allions quelque part ou que nous nous promenions simplement, nous sommes obligés de faire des détours et de supporter le bruit et la laideur de ces travaux omniprésents. Nous nous faisons parfois même casser les oreilles chez nous, si par malheur il y a un interminable chantier de construction à proximité. On dirait que la fonction première des villes et des quartiers où nous habitons est de permettre à l’industrie de la construction d’engranger d’importants profits et de faire marcher ou de relancer l’économie – un peu comme le complexe militaro-industriel aux États-Unis – en réparant les mêmes tronçons qui semblent toujours avoir besoin d’être réparés.
Les employeurs qui autorisent le télétravail, mais qui ne veulent pas aller jusqu’au bout et qui continuent de demander quelques jours par semaine de présence dans les bureaux sous prétexte de cohésion d’équipe, ne traitent pas leurs employés avec plus de considération. Les bureaux attitrés que les employés pouvaient aménager à leur gré, et où ils pouvaient laisser leurs effets personnels, sont peu à peu abolis et remplacés par des bureaux uniformisés et partagés que les employés utilisent à tour de rôle quand ils vont travailler « en présentiel ». L’objectif est d’économiser de l’espace en n’ayant plus de bureaux inoccupés deux ou trois jours par semaine. Cette nouvelle tendance s’appelle la dépersonnalisation des espaces de travail, puisque les espaces de travail ne doivent pas être personnalisés par leurs utilisateurs et demeurer attribuable à n’importe lequel d’entre eux. Ainsi, plus personne n’a de bureau à lui et ne peut être chez lui à son poste de travail temporaire, qui demeure entièrement sous le contrôle de l’employeur, au lieu de lui être concédé.
Il arrive aussi que les employeurs qui autorisent leurs employés à faire du télétravail, en leur demandant ou non d’être au bureau quelques jours par semaine, leur imposent des exigences quant au bureau qu’ils doivent avoir à domicile. Certains employeurs font signer une entente de télétravail qui exige un bureau aménagé spécialement pour le travail, tranquille et permettant d’assurer la confidentialité des appels par vidéoconférence ou téléphoniques vis-à-vis des autres personnes qui habitent dans le même logement et, dans le cas d’un appartement, des voisins. Ce qui revient pratiquement à demander une pièce attitrée pour qui n’habite pas seul et un déménagement dans une maison ou un appartement plus grand pour qui habite dans un petit appartement. S’il est vrai que des employeurs peuvent défrayer une partie des dépenses liées à l’aménagement de ce bureau (par exemple l’achat d’un écran d’ordinateur, d’une chaise ergonomique et d’une table de travail), ils ne paient pas à leurs employés l’espace qu’ils s’approprient dans leurs domiciles, pas plus qu’ils ne remboursent les déménagements parfois nécessaires pour satisfaire ces exigences ou être en mesure de travailler efficacement. Heureusement, les employeurs peuvent difficilement, pour l’instant, vérifier la satisfaction de ces exigences.
Il devient de plus en plus coûteux et difficile, pour tous ceux d’entre nous qui ne sont pas riches ou à tout le moins aisés, de trouver une maison, un condominium ou un appartement assez grand et assez beau où nous pouvons vraiment nous sentir chez nous. Dans beaucoup de villes et d’arrondissements, les coûts d’achat ou de location sont prohibitifs. La demande immobilière est forte, l’évaluation municipale des propriétés augmente et les grandes sociétés immobilières profitent de la situation puisqu’elles possèdent une partie toujours plus grande des appartements à louer, soit qu’elles achètent des propriétés à de plus petits propriétaires, soit qu’elles en construisent de nouvelles, en ajoutant toutes sortes de services (lave-vaisselle, internet et télévision compris, piscine, sauna, salle d’entraînement, salle de billard, etc.) pour faire grimper démesurément le montant des loyers. Il en résulte que nous avons de bonnes raisons de sentir que nous sommes de moins en moins chez nous dans ces villes, et de penser qu’on cherche à nous repousser en périphérie de ces villes, où le montant des loyers et des propriétés immobilières augmente justement à cause de ce déplacement de la population. Même la migration dans les régions, pour ceux pour qui c’est possible, devient de plus en plus coûteuse pour les mêmes raisons. Et encore là, il n’est pas certain que nous puissions disposer librement de notre société, puisque certaines municipalités s’amusent à complexifier inutilement la réglementation pour faire installer des panneaux photovoltaïques ou avoir quelques poules, par exemple. Voilà qui explique, entre autres, pourquoi de nombreux Canadiens émigrent tous les ans tant il est difficile de trouver un endroit où nous nous sentons chez nous et d’y rester.
Dans l’hypothèse où nous réussissons à trouver malgré tout un domicile et un quartier où nous nous sentons chez nous sans nous ruiner, on s’ingère de plus en plus dans nos milieux de vie grâce aux technologies de surveillance de masse. Les caméras se multiplient non seulement dans les lieux publics intérieurs et extérieurs, dans les transports en commun, mais sont aussi apparues dans les immeubles à logement, de même que dans nos voitures et à l’intérieur de nos domiciles, où il y a aussi des microphones, à cause des systèmes de reconnaissance vocale utilisés par les gadgets à la mode. Sans parler des ordinateurs que nous laissons fonctionner toute la journée. Sans parler des téléphones intelligents que nous avons presque toujours sur nous et qui nous suivent partout où nous allons. Pour peu que nous y pensions, nous avons l’impression d’être constamment surveillés et nous nous retrouvons alors à faire attention à ce que nous faisons et disons, ce qui n’est pas compatible avec le fait de nous sentir chez nous, que nous soyons dans un lieu public ou à notre domicile.
On nous fait donc sentir que nous ne sommes vraiment chez nous nulle part, certainement pas dans les lieux publics et pas même dans nos domiciles, dont nous pouvons de moins en moins disposer librement. Par conséquent, serions-nous en train de nous retrouver dans une situation analogue à celle des esclaves auxquels les maîtres ne laissaient rien en propre ?